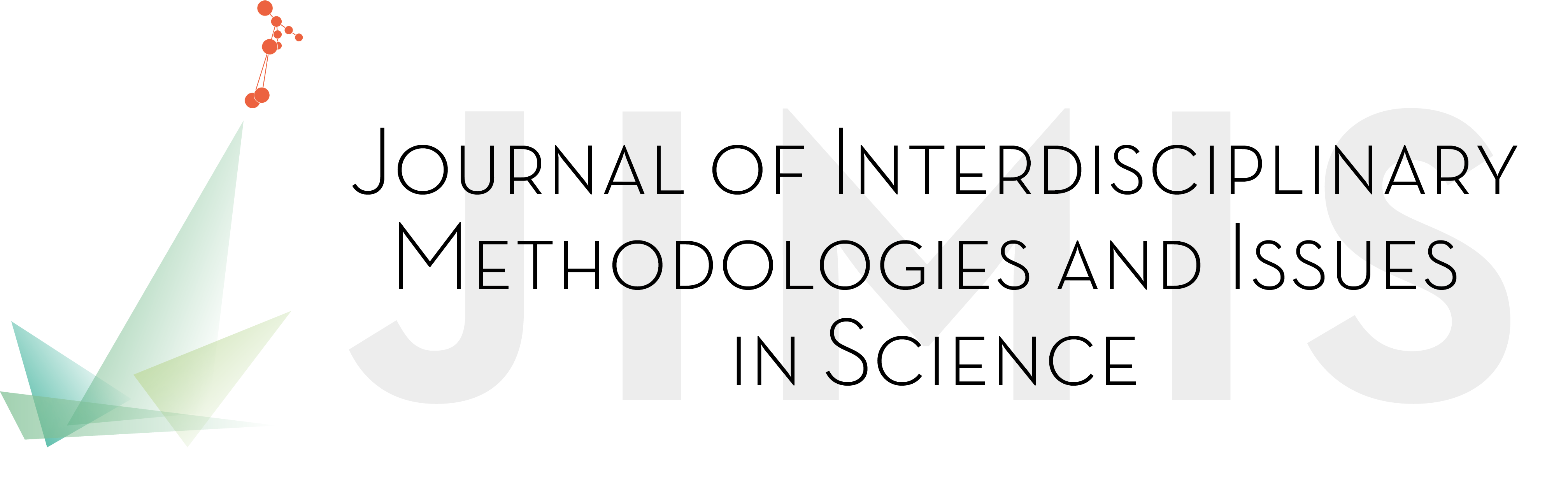 |
Vol. 12 - Sciences de l’information géographique & mesures environnementales
Éditeurs invités : Thierry Badard (Université Laval, Québec), Jacynthe Pouliot (Université Laval, Québec), Matthieu Noucher (CNRS, Bordeaux), Marlène Villanova (Université Alpes Grenoble).
Dans le prolongement de la conférence Spatial Analysis & Geomatics (SAGEO’23) qui s’est tenue en juin 2023 sur le campus de l’Université Laval à Québec [1], ce volume spécial de JIMIS vise à publier en libre accès des travaux de recherche sur les enjeux méthodologiques de la spatialisation des mesures environnementales.
Les mesures environnementales peuvent être appréhendées selon une double acceptation : d’une part, elles peuvent faire référence à l’action d'estimer les dimensions d’un objet ou d’un phénomène relatif à l’environnement. L’évaluation des surfaces impactées par la déforestation en est un bon exemple. D’autre part, elles peuvent renvoyer aux moyens mis en œuvre en vue d’un résultat déterminé. En ce sens, elles sont synonymes des politiques publiques élaborées, par exemple, pour réduire les effets de l’érosion côtière. Les sciences de l’information géographique contribuent couramment aux mesures environnementales dans les deux sens du terme : à la fois pour estimer les dimensions et dynamiques environnementales et pour évaluer les moyens et effets des politiques environnementales. La géomatique peut ainsi être mobilisée aussi bien pour capter, prélever, analyser, visualiser diverses composantes de notre milieu que pour diagnostiquer, planifier ou simuler les impacts de projets d’aménagement. Or, la pluralisation des modalités (*in situ* ou à distance) et des vecteurs (aériens, terrestres, maritimes) de collecte de l’information environnementale incite aujourd’hui à envisager un renouvellement des méthodes de traitement et d’analyse dans des perspectives interdisciplinaires qui permettent de « faire parler » les données autrement.
L’objectif de ce volume spécial est de proposer, via une grande diversité d’approches, d’échelles, d’objets, de terrain, un regard pluriel sur les défis scientifiques de l’usage des sciences de l’information géographique pour mettre en chiffres et en cartes les questions environnementales. Des exposés présentés lors de la conférence SAGEO, sélectionnés par le comité de programme, seront invités à soumettre une proposition originale mais ce dossier est aussi ouvert à d’autres contributions.
**Dates** :
- 23 novembre 2023 : lancement de l’appel à communication
- Réception, évaluation (double aveugle) et publication des articles retenus au fil de l’eau
- 1er juin 2024 : fermeture de l’appel, fin définitive des soumissions
[1] SAGEO est la conférence internationale francophone en géomatique soutenue par le groupe de recherche CNRS MAGIS (
1. Recyclage des données pour la planification spatiale marine: examen des plans maritimes en Europe
Le domaine des études en Planification Spatiale Marine (PSM) basée sur les approches écosystémiques suscite une attention croissante en raison des exigences de la directive 2014/89/UE. À ce jour, la recherche sur les approches écosystémiques s’est principalement concentrée sur les méthodes utilisées pour mettre en place des études visant à évaluer l'impact des activités marines humaines sur les écosystèmes. Ce document présente un examen des plans marins européens, en se concentrant en particulier sur les données et les cartes utilisées pour traduire la PSM. Cette étude devrait contribuer à notre compréhension de la notion d'enchevêtrement dans la planification. Nous nous appuyons sur des études de données critiques, et en particulier sur la théorie de l'intra-action et le concept d'information en-information, pour comprendre les biais des données et des cartes. Nous avons déployé une analyse de contenu portant sur les plans maritimes en Europe au regard de 4 indicateurs principaux permettant d'évaluer les usages des données et des cartes dans les PSM au regard de l’approche écosystémique. Globalement, nos résultats suggèrent que l'approche écosystémique est peu retranscrite dans les cartes en raison d'un manque de jeux de données adaptés, de contraintes géotechnologiques ou de décisions politiques. En particulier, nous observons un recyclage des données à des fins de planification. Notre […]
2. CentipedeRTK, un réseau pour la géolocalisation haute précision au service de l'environnement
Le positionnement RTK ou Cinématique Temps réel est une technologie éprouvée qui permet d’améliorer le positionnement fourni par un récepteur mobile GNSS, en se basant sur un réseau de récepteurs à antenne, fixes, servant de référence, positionnés précisément sur le territoire. Bien que très efficace, cette solution reste encore très coûteuse et n’est donc pas à la portée de tous les utilisateurs. L’émergence des produits électroniques low-cost a permis au réseau CentipedeRTK de voir le jour. Celui-ci se base sur l‘ouverture et le partage d’une méthodologie de construction d’antennes RTK mises en réseau pour un usage libre et collaboratif, quelle que soit la finalité de son utilisation. Depuis son démarrage en 2019, le réseau ne cesse de croître et ses usages se multiplient dans différents domaines, allant de la recherche forestière jusqu’au suivi des mesures environnementales.
3. Tetiaroa diachronic geomorphology 1955 -2023 Monitoring the shoreline and vegetation cover of tropical atoll in the climate change context
The Tetiaroa atoll is virtually free of anthropogenic pressure, making it a textbook case for observing the impact of climate change on the pristine coral atolls of French Polynesia. A geospatial databasedating back to 1955 was used to map and analyze erosion and accretion phenomena on the atoll's motu (Tahitian name for islets). Its diachronic analysis documents two types of motu: those with a coralline base, which experience minimal movement over time, and the sandy motu which, on the contrary, exhibit significant dynamics linked to strong swells and storms. While we cannot yet link the observed dynamics to climate change and rising sea levels, these results will help us better understand the future impacts of extreme climatic events on Polynesian atolls.
4. Enjeux géonumériques pour l'évaluation environnementale des projets urbains : premiers résultats du projet EcoCIM
La réduction des impacts environnementaux du parc bâti (construction, usage, réhabilitation, fin de vie) est nécessaire pour atteindre un rythme soutenable de consommation des ressources planétaires. L’analyse de cycle de vie (ACV) permet à un maître d’ouvrage d’évaluer plusieurs catégories d’impacts environnementaux d’un projet urbain (atteintes à la santé humaine, atteintes à la biodiversité, etc.) afin de faire les choix les plus sobres possibles. Cette évaluation nécessite des données nombreuses et les plus représentatives possible des territoires concernés. Face aux difficultés rencontrées lors de la prise en compte de la dimension géographique, un projet exploratoire et interdisciplinaire a été lancé afin d’identifier les besoins géonumériques émergeant lors de la réalisation de l’ACV d’un projet urbain. Cet article présente les premiers résultats du projet en décrivant d’abord les enjeux liés à la spatialisation de l’ACV puis une partie des défis rencontrés plus spécifiquement dans le contexte de l’ACV des projets urbains. Il a pour objectif de participer à la définition d’un programme de recherche pour améliorer la prise en compte de la dimension géographique dans les ACV de projets urbains et de porter à la connaissance de la communauté en sciences et techniques de l’information géographique les problématiques rencontrées par les chercheurs en évaluation environnementale qui développent des […]
5. Un apport des géodonnées pour l'analyse de cycle de vie de projets urbains : prise en compte des masques solaires dans les simulations thermiques dynamiques de bâtiments
L'analyse de cycle de vie (ACV) peut être utilisée pour évaluer les impacts environnementaux d'un projet urbain, mais nécessite un très grand nombre de données. Or, de nombreuses géodonnées aujourd'hui disponibles sont mobilisables dès la phase de conception. Nous explorons ici l'apport possible de référentiels géonumériques existants à l'amélioration de la précision des simulations thermiques dynamiques (STD) réalisées lors d'ACV de projets urbains. Pour cela, nous avons construit un modèle permettant d'évaluer l'influence des masques solaires sur les besoins énergétiques de bâtiments et sur le confort thermique à l'intérieur de ces derniers. Nous utilisons ce modèle pour évaluer l'intérêt de prendre en compte ces masques. Nous testons ensuite l'utilisation de référentiels IGN existants afin de produire des données sur les masques solaires formés soit par les bâtiments seuls (BD TOPO), soit par les bâtiments et la végétation (LIDAR HD). Après avoir validé notre modèle, nous l'utilisons sur deux bâtiments déjà construits, pour comparer les résultats des simulations sans masque et avec les masques issus des référentiels. Ces premiers tests confirment l'intérêt d'utiliser les référentiels existants. Ils nous invitent également à poursuivre vers la formalisation de recommandations pour les développeurs d'outils STD et ACV, et à explorer […]
6. Méthode de classification et de cartographie des écosystèmes de carbone bleu pour la réalisation d'un bilan carbone : le cas d'étude de l'agglomération de La Rochelle
Dans un contexte de changement climatique global, la France s'est engagée vers la neutralité carbone. Le territoire de La Rochelle, à travers le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, vise à atteindre cet objectif en valorisant ses écosystèmes de « carbone bleu ». Cette étude propose une typologie des écosystèmes de carbone bleu rochelais présents le long d'un continuum terre-mer, établissant une classification inédite de sept types de milieux susceptibles d'être des puits de carbone : marais doux, saumâtres et salés ainsi que prés salés, vasières, herbiers et océan. Un second niveau de classification a été introduit pour les marais rétro-littoraux, attribuant la notion de carbone bleu uniquement aux surfaces aquatiques. Cette distinction entre les surfaces en eau et les surfaces émergées soulève des interrogations sur la séparation entre carbone bleu et carbone vert. De plus, une base de données géographique a été créée, accompagnée de cartographies permettant de localiser ces milieux et d'évaluer leur superficie, afin d'assister les gestionnaires et collectivités dans leur mission de préservation et d'évaluation du potentiel de captation et de séquestration du carbone. Les limites de l'étude portent sur la subjectivité du périmètre maritime assigné au territoire et sur la catégorisation des écosystèmes entre carbone bleu et carbone vert. Cette typologie innovante, soutenue par un […]